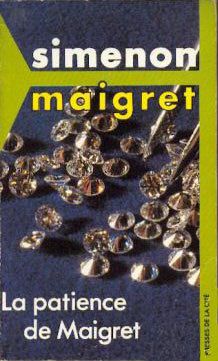
Suite de Maigret de défend, dans lequel le commissaire a dû faire face aux accusations calomnieuses d’un psychopathe, La patience de Maigret commence sous un bon jour pour Maigret qui, dès son petit-déjeuner, savoure la beauté de Paris sous le soleil de juillet :
Les fenêtres de l’appartement étaient larges ouvertes, laissant pénétrer les odeurs du dehors, les bruits familiers du boulevard Richard-Lenoir, et l’air, déjà chaud, frémissait ; une fine buée, qui filtrait les rayons du soleil, les rendait presque palpables. (2007-VIII : 533)
Une journée qui va se poursuivre pour quelques heures dans l’insouciance, avec par exemple, ce tableau impressionniste de la ville :
En fin de matinée, les avenues, les rues de Paris étaient un véritable feu d'artifice dans la chaleur de juillet et on voyait partout des éclaboussures de lumières ; il en jaillissait des toits d'ardoises et des tuiles roses, des vitres des fenêtres où chantait le rouge d'un géranium ; il en ruisselait des carrosseries multicolores des autos, du bleu, du vert, du jaune, des klaxons, des voix, des grincements de freins, des sonneries, du sifflet strident d'un agent. (2007-VIII : 615)
/image%2F3165035%2F20210206%2Fob_935762_acacias-4-retouche.jpg)
La réalité prend le dessus quand Manuel Palmari, un truand officiellement retiré des affaires, invalide depuis un règlement de comptes, est assassiné chez lui. Palmari est une vieille connaissance de Maigret à qui il parfois servi d’indicateur et avec qui se sont tissés « des liens subtils, difficiles à définir ». L’enquête, bouclée en deux jours seulement, met un terme à la longue traque par la PJ d'un gang qui dévalise les bijouteries, évoquée dans le roman précédent, soit l’unique exemple dans la série d’une histoire développée dans un diptyque.
A partir d’une affaire somme toute banale, La patience de Maigret est surtout un excellent exemple de la façon dont Maigret mène ses enquêtes.
Le terrain. L’action se déroule en grande partie sur les lieux du crime, dans l’immeuble de la rue des Acacias, dans le quartier des Ternes, où Maigret a l’impression de parcourir « une sorte de Paris condensé » : une Américaine excentrique, le barman d’un grand hôtel, des rentiers, deux représentants de commerce, une pédicure, un moniteur de gymnastique, un vieil homme sourd et muet qui aura son importance dans l’histoire, des bonnes occupant les chambres du dernier étage, sans oublier la victime et sa compagne. Fidèle à ses habitudes plus qu’à une méthode dont il ne veut pas entendre parler, comme il l’explique au nouveau juge d’instruction avec qui il collabore (et sympathise, une fois n’est pas coutume), Maigret interroge, monte les étages, fait « du porte-à-porte, comme un marchand d’aspirateur », flaire, prend position dans un bistrot ou dans une loge de concierge, s’imprègne de l’atmosphère…
Si le préfet pète sec avait pu voir Maigret en ce moment, ne l'aurait-il pas encore accusé de se livrer à un travail indigne d'un divisionnaire ?
Pourtant, c'est ainsi que le commissaire avait réussi la plupart de ses enquêtes : en montant les escaliers, en reniflant dans les coins, en bavardant à gauche et à droite, en posant des questions futiles en apparence, en passant des heures dans des bistrots parfois peu recommandables. (2007-VIII : 568)
La chansonnette. Bien qu’elle n'ait pas lieu dans le cadre formel du bureau de Maigret au quai des Orfèvres, la « conversation » qu’il a avec le maître d’hôtel du Clou Doré, un restaurant appartenant à Palmari, est un parfait exemple de ce type d’interrogatoire « bon enfant, cordial, avec l’air de n’attacher aucune importance aux questions posées » que le commissaire affectionne et qui porte très souvent ses fruits.
L’instinct. C’est ce qui amène Maigret, lors de la confrontation avec Barillard, le voisin de palier de Palmari et l’un des suspects, à ne pas l’assommer de preuves mais à « éveiller l’inquiétude du représentant de commerce, à le mettre volontairement sur ses gardes ». Une pratique qui a le don d’irriter les juges d’instruction, Cornéliau en particulier, car elle ne s’appuie sur aucune preuve tangible ou vérification préalable. On notera également l’habilité de Maigret qui coupe toute possibilité de contact et de communication entre les suspects pour les laisser à leurs interrogations et à leur peur. Tactique qui s’avère payante et amène à un règlement de comptes final entre deux êtres liés par une relation charnelle bestiale, « explosion d’animalité » qui tournera au « combat de fauves » dans le bureau de Maigret devant un juge d’instruction abasourdi.

Le bonheur sensuel de la belle journée d’été du début du roman, commencée « comme un souvenir d’enfance, éblouissante et savoureuse », est bien loin quand celui-ci s’achève. Maigret, patient, a certes conclu une enquête qui durait depuis vingt ans, ce qui lui a donné l’occasion de revenir sur des épisodes de sa carrière depuis ses débuts comme secrétaire du commissaire du quartier Saint-Georges (La première enquête de Maigret), mais il reste sur une impression amère : Palmari, pour qui, dans un certain sens, il avait un faible, est mort et, avec lui disparaît « un truand de la vieille école, un truand à papa », et aussi une époque. L’enquête terminée, face à deux êtres dont le destin appartient maintenant à la justice, il retient surtout le souvenir d’un événement tragique de la guerre que lui a raconté un témoin, le bombardement de trains de réfugiés à Douai « un jour de jugement dernier », quand une petite fille a pris la main d’un vieil homme et ne l’a pas lâchée jusqu’à la rue des Acacias.
Georges Simenon, La patience de Maigret, © Paris, Presses de la Cité, 1965 et Omnibus, 2007

/image%2F1186627%2F20190119%2Fob_f2e61e_maigret-3.JPG)